Archive
« A chaque instant, la ruine »: Le dernier crâne de M. de Sade, de Jacques Chessex
 Sur le bandeau promotionnel de chez Grasset, on peut voir un Jacques Chessex au regard inquisiteur, tout habillé de noir comme une sorte de vieil activiste aux cheveux blanc-sépulcre, passer la main derrière un rideau pour voir le jour, là-bas, derrière la vitre, dans le monde. Belle image, qui est pour le coup aussi une sorte d’illustration du métier d’écrivain (et d’artiste); tel que l’a décrit Henry James dans sa préface à The Portrait of a Lady:
Sur le bandeau promotionnel de chez Grasset, on peut voir un Jacques Chessex au regard inquisiteur, tout habillé de noir comme une sorte de vieil activiste aux cheveux blanc-sépulcre, passer la main derrière un rideau pour voir le jour, là-bas, derrière la vitre, dans le monde. Belle image, qui est pour le coup aussi une sorte d’illustration du métier d’écrivain (et d’artiste); tel que l’a décrit Henry James dans sa préface à The Portrait of a Lady:
« The house of fiction has in short not one window, but a million– a number of possible windows not to be reckoned, rather; every one of which has been pierced, or is still pierceable, in its vast front, by the need of the individual vision and by the pressure of the individual will. These apertures, of dissimilar shape and size, hang so, all together, over the human scene that we might have expected of them a greater sameness of report than we find. They are but windows at the best, mere holes in a dead wall, disconnected, perched aloft; they are not hinged doors opening straight upon life. But they have this mark of their own that at each of them stands a figure with a pair of eyes, or at least with a field-glass, which forms, again and again, for observation, a unique instrument, insuring to the person making use of it an impression distinct from every other. »
C’est bien par cette fenêtre que Jacques Chessex portait son regard lucide, acéré sur la vie à travers elle que nous voyons en lisant ses livres. Cette fenêtre s’est fermée en octobre dernier, lorsque l’auteur est brutalement décédé, d’une crise cardiaque; « soyons des voleurs de feu », disait l’Autre – Chessex, lui, vivait de son feu intérieur et s’est laissé consumé par lui, nous laissant un dernier roman, Le dernier crâne de M. de Sade, remis à son éditeur quelques temps avant sa mort.
Le dernier crâne… est un roman étrange, intelligent, écrit superbement, construit de façon à la fois originale et ambigüe. On peut distinguer deux récits dans le roman, dont le point commun est le marquis de Sade et plus particulièrement son crâne. La première partie du roman s’attache à raconter les derniers mois du « divin » Marquis enfermé à l’hospice de Charenton, où il continue à « poursuivre l’oeuvre de chair », bien qu’il soit malade et mourant. Son amante préférée est la jeune Mademoiselle Leclerc, 16 ans, « une vraie petite salope sous ses airs d’ange transparent » (p.37), qui l’assiste dans ses noires nuits blasphématoires et sodomites. La seule crainte du Marquis est de se faire autopsier après sa mort (et que l’on découvre la nature réelle de ses vices?), surtout qu’il n’y ait pas de croix sur sa tombe, et il fait promettre à son jeune médecin, le Docteur Ramon, de respecter ses dernières volontés.
C’est le même Docteur Ramon qui récupèrera le crâne de Sade lors du grand « bouleversement » (p.105) du cimetière de Charenton d’août 1818, pendant lequel la tombe de l’auteur de Justine est ouverte. Ramon s’empare alors du crâne du Marquis, crâne qui devient vite l’objet de rumeurs: il serait possédé de l’âme du blasphémateur suprême, posséderait des pouvoirs magiques, donnerait une énergie sexuelle surnaturelle (et mortelle) à son possesseur, etc. C’est ici que commence le deuxième récit du roman, celui des aventures du crâne de Sade, et des sept fois où l’on a eu vent de son apparition dans le monde. Ce récit est pourtant annoncé dès le départ par le personnage de Sade lui-même, qui, par une sorte de prescience, parle aux autres personnages de son « dernier crâne », dernier crâne dont nous, lecteurs, entendrons parler seulement à la fin, lorsque le narrateur, qui jusqu’à présent n’avait quasiment pas pris la parole en son nom, se contentant de narrer l’histoire, parle de son expérience avec le crâne maudit. Narrateur ambigu, hésitant pendant tout le livre entre l’éloge et la réprobation morale du Marquis, et qui nous permet de comprendre que le personnage pivot du roman est en fait lui, et que son hésitation n’est que le reflet de l’attirance et de la répulsion que suscitent les monstres (et Chessex en connaissait un rayon) chez les gens ‘normaux’.
Le dernier crâne de M. de Sade n’est pas seulement le récit historique des derniers mois de Sade mais aussi un roman, et par là-même, un des plus grands hommages littéraires que l’on pouvait faire à Sade.

Le dernier crâne de M. de Sade, Jacques Chessex, Grasset, 12 euros.
Michel Onfray, ou la suspension de la pensée
Voici un article écrit par un ami à moi sur Michel Onfray, philosophe médiatique dont vous avez peut-être (ironie, ironie quand tu nous tiens) entendu parler. L’adresse du blog original se trouve après l’article, et j’invite tous les lecteurs de ce blog à y faire un tour (et même deux).
Jonathan
PS. Mon titre d’article est volontairement polémique, pas besoin de pousser des cris d’Onfray.
« Michel Onfray et la suspension
Au fur et à mesure que je le fréquente à la lecture de ses livres, Michel Onfray est un personnage (non pas une personne dont je ne saurais juger: on ne perçoit la personne qu’à travers son masque d’auteur, bien que le clivage narrateur/auteur tende beaucoup à s’estomper chez lui) qui m’est de plus en plus sympathique. Déjà, en voyant son parcours qu’on peut, pour le moins, qualifier de courageux: démissionner d’un poste de prof de philo pour fonder une université libre (celle de Caen, en l’occurrence) ne doit pas être une décision facile à prendre, et marque un certain courage: il faut être sûr de son coup pour faire un truc pareil. Respect.
Ensuite en le lisant. J’avoue 1/ne pas avoir tout lu, et 2/ne pas avoir toujours terminé les livres que j’ai commencés (le traité d’athéologie, notamment, m’est tombé des mains). Mais son écriture est toujours d’une grande clarté, oscillant entre désir d’être compris du vulgus pecum (expression qu’il doit détester, je pense) et érudition très précise. Manifestement, Onfray a lu, beaucoup lu et beaucoup réfléchi à ce qu’il lisait, de manière on ne peut plus personnelle.
Se dégage de ses livres (ceux que j’ai lus, pour le moins) une sensibilité à fleur de peau, une capacité à intégrer dans sa pensée des éléments qui a priori ne font pas l’objet d’une conceptualisation, à concilier le paysan et le philosophe afin d’embrasser dans sa philosophie une sorte de totalité réconciliant corps et âme. Son petit bouquin sur le Sauternes, par exemple, est éloquent à cet égard, on y sent une grande influence de Bachelard, on croirait presque lire le sixième volume de la suite de livres que l’épistémologue avait consacrés aux éléments, sans néanmoins la plume géniale de son illustre prédécesseur. Ne fait pas du Bachelard qui veut. Se dégage parfois également, et c’est cela qui me le rend encore plus sympathique, une certaine mauvaise foi, en particulier dans ses écrits philosophiques. Toute pensée globalisante, systématisante si j’ose dire, passe nécessairement par une sorte de réduction, d’assimilation des faits, des textes et des images. Et cela est systématique chez lui, au point parfois de ne pas le sentir toujours très à l’aise dans son propos. Non. Ou plutôt d’une certitude tellement inébranlable dans sa philosophie du corps, à tel point que c’est le lecteur qui a tendance à décrocher et à vouloir se sortir de ce discours si univoque, lequel est si convaincu, si ferme qu’il nous met parfois mal à l’aise.

Et encore, ce n’est pas tout à fait ça. La pensée de Michel Onfray, et c’est pour cela que le terme de « mauvaise foi » me venait, est redoutablement incisive avec tous ceux qui ne sont pas d’accord avec Michel Onfray. Voilà c’est ça. Ce spécialiste de Nietzsche manie le discours avec une telle virtuosité (Sarkozy en avait d’ailleurs fait les frais: bien joué Michel) qu’il devient, pour ainsi dire, difficile de discuter avec lui intellectuellement, il propose une pensée sans faille, sans porte de sortie en quelque sorte. Et cela est tellement récurrent qu’on n’en a même plus envie de laisser tomber, on se laisse prendre dans une sorte de second degré car, après tout, ses arguments, même s’ils ont parfois un petit goût de déjà lu, sont quand même bien structurés, argumentés, révélateurs d’une pensée en continuel mouvement. Et c’est cela qui me plaît le plus chez Onfray: sa capacité à faire partager le mouvement de sa pensée. De sa pensée et de ses goûts, comme en témoigne l’ouverture de son université du goût ou l’étendue des domaines sur lesquels il écrit et dont il parle.
Une pensée en suspension, finalement. Le mot m’est venu en lisant son deuxième volume de sa contre-histoire de la philosophie, dont Onfray a eu le bon goût de la faire paraître en livre de poche, contrairement à d’autres bouquins que je n’achèterai qu’une fois qu’ils seront sortis dans des collections de ce genre (le Mille Plateaux de Deleuze et Guattari, par exemple). Onfray a un tic d’écriture qui m’insupporte, qui m’a toujours insupporté en littérature: les points de suspension. Ils me paraissent d’autant plus condamnables en philosophie que ce domaine de la pensée doit laisser le moins possible de zones d’ombre, de sous-entendus, de choses non-dites et que le lecteur doit deviner. Et pourtant ils sont systématiques, on en trouve au moins à deux reprises à chaque page. Ca fait un petit effet « je n’en dis pas plus, vous avez tout compris, c’est édifiant, même pas la peine que je précise », et ça, surtout chez un philosophe -je me répète-, ça m’agace terriblement. Prenons une page, vraiment, au hasard: « Epicure fournit un arsenal capable de mettre à mal le christianisme au pouvoir en offrant une métaphysique, une éthique, une sagesse, une politique de rechange. Péché mortel pour des philosophes… », ou encore « Jean enseigne que naître de Dieu empêche d’être souillé par le péché car en chacun reste toujours la trace de la divinité ? Le Libre-Esprit conclut que la grâce subsistent et que les actes comptent pour rien, jamais… » Dieu que ça m’agace. Procédé rhétorique, je veux bien, pratique aussi car il évite des digressions qui augmenteraient le volume du livre d’un bon tiers. Mais il reste que c’est prodigieusement agaçant car on s’en lasse. Les points de suspension d’Onfray n’ont pas la violence de ceux de Céline, de sorte qu’on en a assez vite marre. Ce tic, enfin, est récurrent dans ses textes historiques et philosophiques, on ne le trouve quasiment plus dans des textes plus personnels, comme celui cité plus haut ou le très beau petit livre Le Corps de mon Père, lu sur les conseils d’une aficionada et que je vais probablement faire lire à mes troisièmes. Ecrire démocratiquement. Une qualité qui rend tous les auteurs sympathiques, celui-ci d’autant plus, malgré les remarques que j’ai faites. »
Source: http://arnheim.canalblog.com/archives/2009/12/03/16015726.html
« Chacun est pour lui-même le plus lointain »
Abel, le patriarche de la famille Vuillard dans Un conte de Noël d’Arnaud Desplechin, cite longuement à un moment du film un texte de Nietzsche, pris de la préface de la Généalogie de la morale. Ce texte étant très beau, je vous le livre tel quel, dans la traduction qu’en a faite Patrick Wotling pour l’édition du Livre de Poche (2000) du classique nietzschéen. Voilà le texte:
« Nous sommes pour nous des inconnus, nous en personne pour nous en personne: il y a à cela une bonne raison. Nous ne sommes jamais partis à la recherche de nous-mêmes, – comment pourrait-il se faire qu’un beau jour nous nous trouvions? C’est à juste titre que l’on a dit: « Là où se trouve votre trésor, se trouve aussi votre coeur »; notre coeur se trouve là où sont les ruches de notre connaissance. Nous sommes toujours en route vers elles, nous qui sommes nés ailés et collecteurs de miel de l’esprit, nous n’avons vraiment qu’une seule et unique chose à coeur – rapporter quelque chose « chez nous ». Quant à la vie, pour le reste, aux soi-disant « expériences vécues », – qui d’entre nous a seulement assez de sérieux pour cela? Ou assez de temps? Pour ce qui est de ces sujets, nous n’avons, je le crains, jamais été vraiment « captivés par le sujet »: notre coeur n’y est justement pas – et même pas notre oreille! Tout au contraire, tel un être en proie à une distraction divine et immergé en lui-même, à l’oreille de qui la cloche vient de sonner ses douze coups de midi à toute volée, qui se réveille en sursaut et se demande: « Qu’est-ce qui vient de sonner au juste? », nous aussi, il nous arrive de nous frotter les oreilles après coup et de nous demander, totalement stupéfaits, totalement déconcertés: « Qu’avons-nous vécu là au juste? », plus encore: « Qui sommes-nous au juste? », et nous recomptons, après coup, comme on l’a dit, l’ensemble de ces douze coups de cloche vibrants de notre expérience vécue, de notre vie, de notre être – hélas! et nous comptons de travers… Nous demeurons justement étrangers à nous-mêmes, de toute nécessité, nous ne nous comprenons pas, il faut que nous nous méprenions sur notre compte, le principe: « Chacun est pour lui-même le plus lointain » s’applique à nous à tout jamais, – à notre égard, nous ne sommes pas des « hommes de connaissance »… »
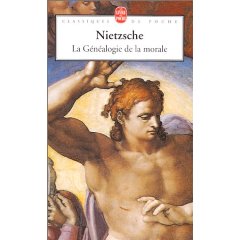
Réactions récentes